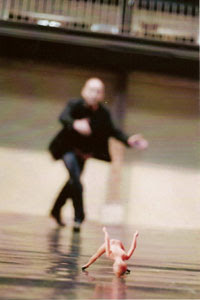Há 2 anos pude participar numa producção de «Les Mamelles de Tirésias», ópera de juventude de Francis Poulenc, bastante pouco conhecida. Esta obra é uma pérola musical, e o libreto do compositor baseado nos textos de Guillaume Apollinaire, uma loucura divertidissima!
Hoje pude assisitir, na Opéra Comique, em Paris, onde em 3 de Junho de 1947, foi criada pela primeira vez esta obra, a uma nova producção... e perceber porque é que esta obra continua a ser desconhecida, mesmo do público francês, e tão pouco apresentada e representada.
Como a ópera em si é curta, decidiram criar um formato «Soirée Dada», preludiando a obra em si com a «Jazz Suite Nº1 – Foxtrot» de Dimitri Chostakovitch, e o ballet «Le Boeuf sur le Toit» de Darius Milhaud... soirée que quanto muito terá posto Poulenc a dar voltas no caixão!
A escolha da encenadora, cenógrafa e figurinista Macha Makeïeff foi de ambientar a acção deste “assemblage” num circo.
Num principio parecia ser interessante, e algumas ideias realmente o eram... mas do foxtrot ao ballet, que de ballet só tinha o boeuf: um boi real que saíu a dar uma volta em cena... chega-se à ópera em si com expectativas que não são para nada alcançadas!
A personagem tripla Thérèse/Tirésias/Cartomancienne, protagonista feminina por excelência, é cantada por Hélène Guilmette, bonita soprano, cuja voz não chega para dar corpo a esta mulher forte e decidida, que grita o seu feminismo a coração aberto. Uma voz pequena e com dificuldades nos agudos, que abundam na partitura, mas quase poderiamos esquecer estas limitações devido à sua entrega fisica e interpretativa ao papel! (Ainda assim, é uma pena que não seja mais audível!)
Ivan Ludlow é um magnífico Le Mari, assim como Werner Van Mechelen está excelente no papel duplo de Le Directeur/Gendarme, apesar de que muitas vezes duvidamos de algumas escolhas musicais na maneira de cantar o papéis... dúvidas que nos atravessam durante toda a obra, com a maioria das personagens...
O dueto Lacouf e Presto está muito bem representado por Loïc Felix e Christophe Gay, a quem não há nada a dizer para além de «Bravo»!
Mas as felicitações acabam-se por aqui. Os três papéis secundários restantes (para além das outras participações por parte de membros do coro) não encontram voz nos seus intérpretes: tanto Le Journaliste de Thomas Morris, como Le Fils de Marc Molomot ou La Marchande de Journaux de Jeannette Fischer são personagens que vivem apenas pela sua interpretação teatral, pois vocalmente não se ouvem (e não é porque a música não esteja escrita), ao ponto de pensarmos se são actores ou cantores os que as interpretam!
É verdade que a encenação circense de Macha Makeïeff exigia de todos uma intensidade fortíssima, mas é uma pena que da participação de Jeannette Fischer seja bastante mais memorável a sua espargata do principio, que o seu papel cantado!
O Coro (da Ópera de Lyon) esteve exemplar na sua entrega teatral, e talvez o mais interessante do espectáculo é a surpresa de ver que os actores em cena desde o principio eram também os cantores.
Mas a encenação circense, ainda que com alguns momentos interessantes, não serviu a obra de Poulenc, e o mais memorável da soirée é o bailarino negro que aparece vestido como Joséphine Baker – real protagonista do «changement de sexe» (pois nem Thérèse/Tirésias nem Le Mari sofrem realmente uma transformação como propõem Poulenc e Apollinaire!)!
Para os amantes de Poulenc e de «Les Mamelles de Tirésias» esta producção é penível e sofremos ao ver-la e ouvir-la... e para os que queiram descubrir esta obra, não nos resta mais que aconselhar-vos a esperar que haja alguma reposição de outra producção (como a de Emilio Sagi) ou que se faça uma nova!